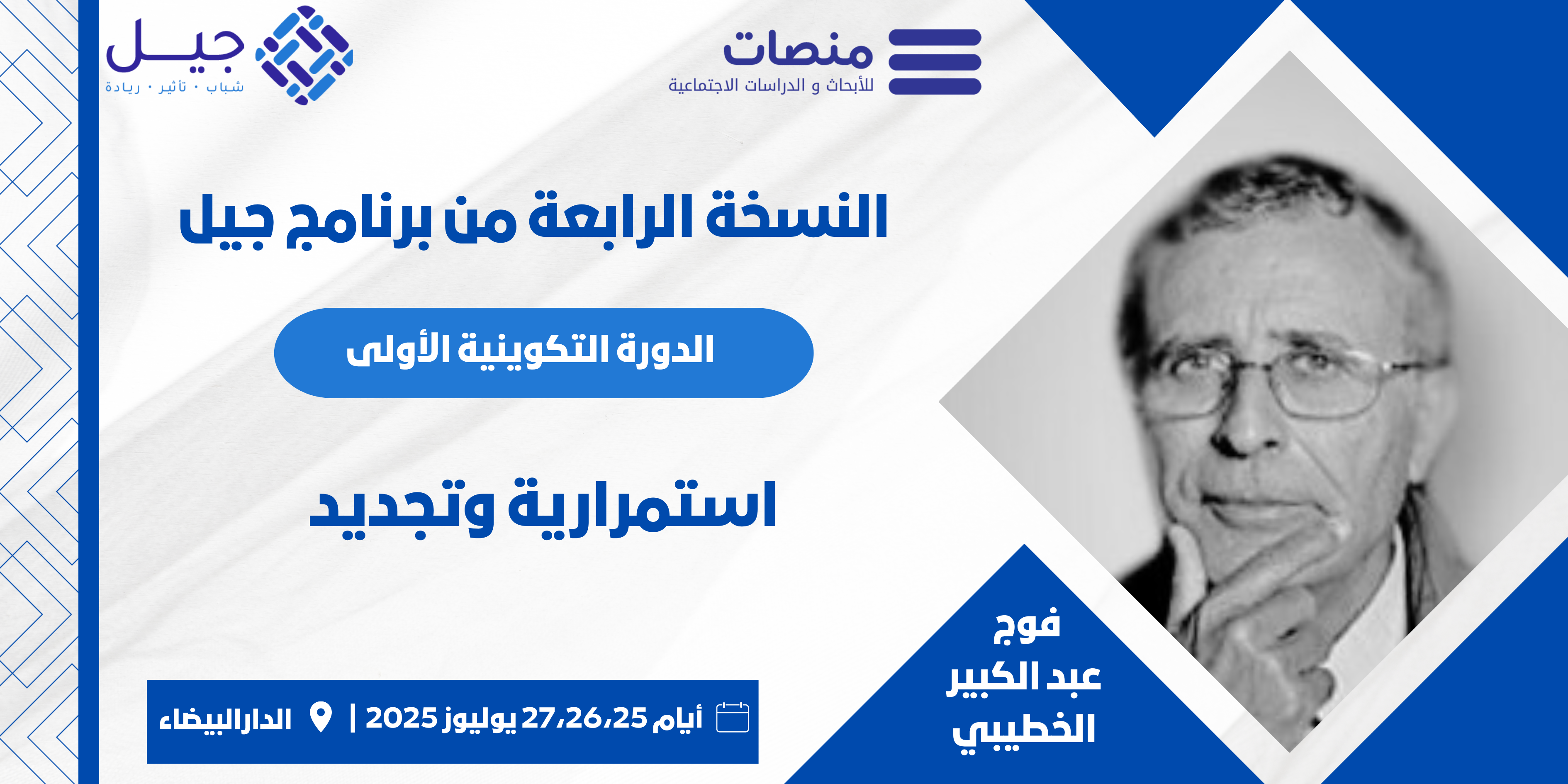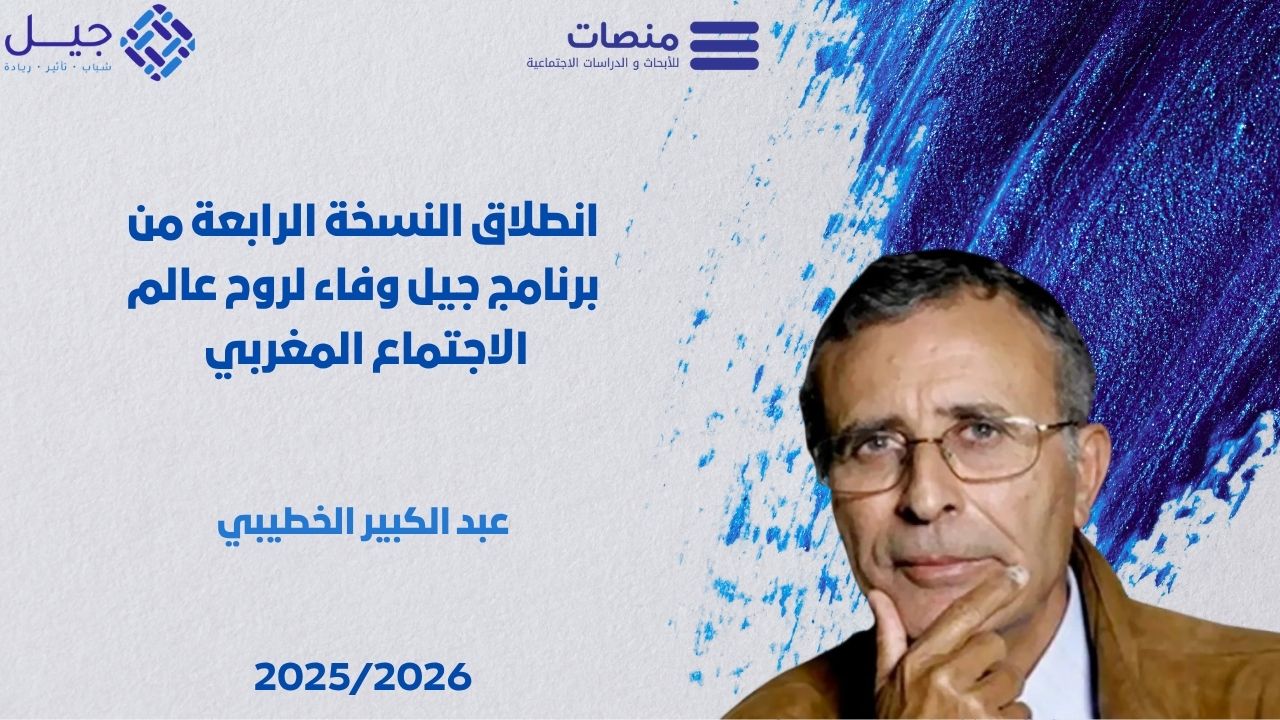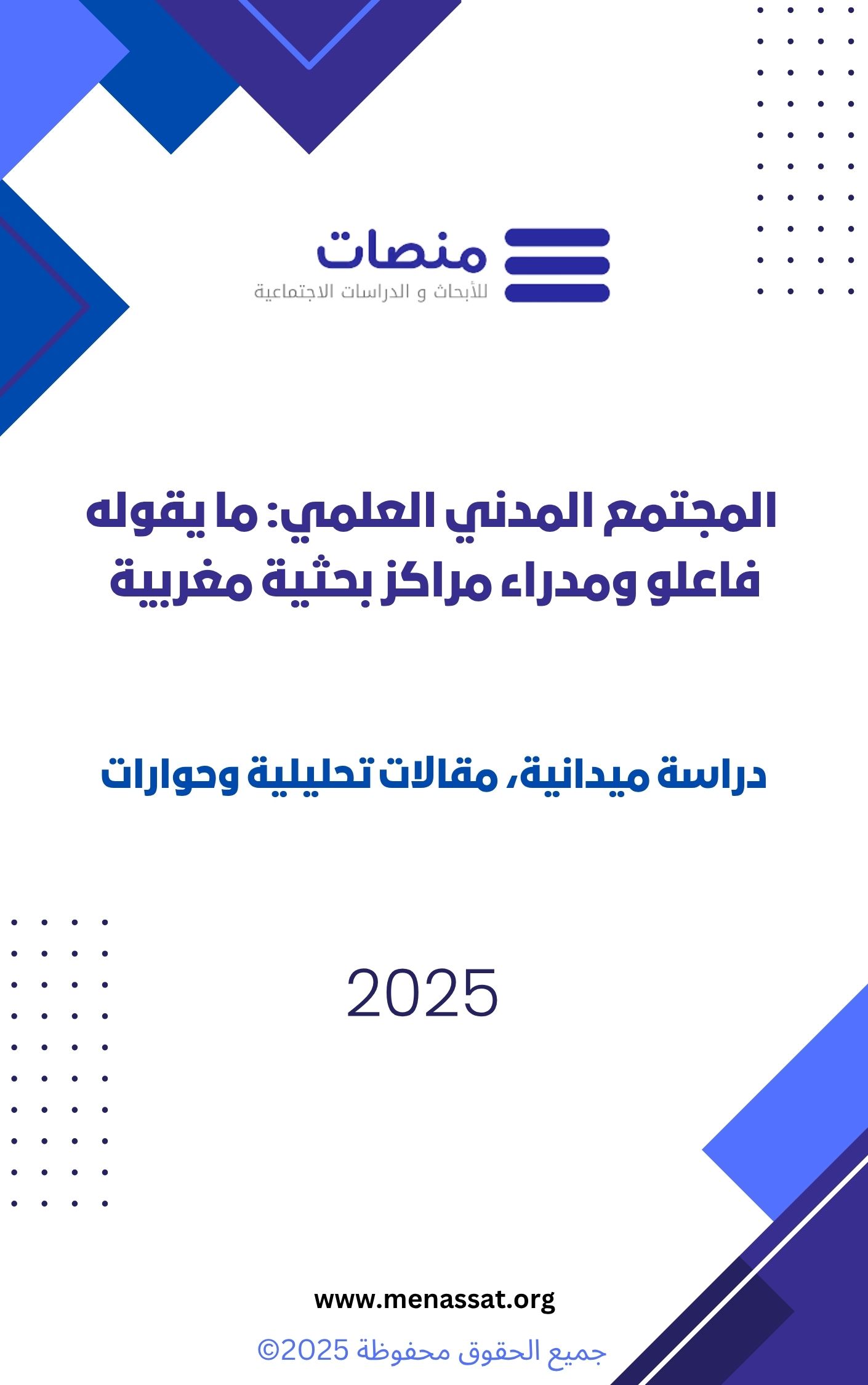Pourquoi faire de la recherche… ou ne pas la faire ? C’est par cette question que le sociologue Jamal Khalil a introduit son intervention lors de la leçon inaugurale qui s’est tenue à la bibliothèque universitaire Med Sekkat de Casablanca. L’événement, qui a réuni de nombreux académiciens, sociologues, chercheurs et doctorants, s’est déroulé le jeudi 20 février à Casablanca.
La recherche comme une quête perpétuelle de compréhension
Lors de son intervention, Khalil, sociologue et professeur émérite, a souligné que « chercher, c’est interroger le monde, se confronter à l’inconnu et tenter d’apporter des réponses aux grandes questions qui traversent l’humanité ». C’est ainsi que la question de « Pourquoi faire de la recherche ? », selon l'intervenant, dépasse la simple curiosité intellectuelle. Elle touche à la vérité, à la liberté de pensée, à la créativité et aux implications sociales du savoir.
Jamal Khalil, l’auteur du « Sociologie, Sociologues, Maroc, So what ? » considère que l'être humain est un être de questionnement. Il n'accepte pas simplement la réalité telle qu'elle est, mais il veut la comprendre, la déconstruire, et parfois même la transformer. Pour lui, cette capacité à questionner en permanence, on la retrouve dans la néoténie, notre aptitude à rester curieux tout au long de notre vie, contrairement à d'autres espèces qui, une fois adultes, cessent d'apprendre.
Faire de la recherche, explique Khalil, c'est prolonger cette curiosité enfantine en un travail structuré et rigoureux. C'est adopter un mode d'existence scientifique qui repose sur des principes clés : la remise en question, l'expérimentation, le dialogue avec les autres chercheurs, mais aussi l'acceptation du doute. Car la recherche, enchaine, Jamal Khalil, n'est pas un chemin linéaire vers la vérité absolue : elle avance par hypothèses, erreurs, controverses et révisions constantes.
L'université et le chemin du chercheur
Dans la même lignée, Khalil, auteur du « Questionnaire en question », aborde la question de l'université comme étant l’un des lieux centraux où se construit la recherche. Dans ce sens, il estime que l'université structure l'apprentissage en plusieurs cycles d'enseignement, depuis la licence jusqu'au doctorat. Chaque étape, dit-il, marque un passage : en partant d'un savoir transmis vers un savoir construit, et de la répétition vers l'innovation.
Pour Jamal Khalil, le passage au doctorat est un moment clé. Il marque l'entrée dans la recherche approfondie, mais il représente aussi un défi qui combine à la fois, selon lui : « Des points forts dont la liberté intellectuelle, l'exploration d'un sujet en profondeur, la participation aux grandes discussions scientifiques et des points faibles dont la précarité, la pression académique et l'isolement dans certaines disciplines ».
Devenir chercheur, explique Khalil, est un cheminement individuel, une construction de soi qui se heurte parfois aux contraintes du socio-système de la recherche. Ces contraintes pour le sociologue, se reflètent essentiellement dans les institutions, les financements, et les politiques de publication qui influencent fortement ce qui est étudié et comment il l'est.
Les paradoxes de la recherche
S’appuyant sur une quarantaine d’années de recherche, Jamal Khalil poursuit son intervention en exposant les paradoxes du monde académique. Il souligne que si l’université se veut un espace de libre pensée, elle demeure néanmoins soumise à diverses pressions, notamment économiques et politiques, parmi lesquelles figure la question de la publication.
Selon lui, publier devient parfois une priorité au détriment de la recherche elle-même, et la créativité peut se retrouver entravée par des exigences institutionnelles. Or, estime-t-il, c’est précisément cette créativité qui constitue le cœur de la recherche. Elle permet d’inventer de nouvelles approches, de s’affranchir des dogmes et d’explorer des problématiques inédites, sans craindre de s’éloigner des sentiers battus. Faire de la recherche insiste Khalil, ce n'est pas seulement produire des connaissances, c'est aussi un dialogue permanent avec la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité, s'interroge le sociologue ?
En science, elle n'est jamais absolue : elle est construite, débattue, prouvée ou réfutée. Elle évolue, dit-il, en fonction des méthodes, des découvertes et des contextes.
L'absence de recherche : un frein au progrès de la société
Toujours en rapport avec la question de la recherche, Jamal Khalil explique que ne pas faire de la recherche, c'est accepter le monde tel qu'il est, sans questionner ce qui nous entoure. C'est un choix possible, mais il limite la capacité d'une société à progresser et à s'adapter, insiste-t-il.
Selon Khalil, faire de la recherche, en revanche, c'est prendre part à une aventure intellectuelle et collective. C'est choisir de rendre un problème intéressant, de poser des questions non pour dominer les autres, mais pour avancer ensemble dans la construction du savoir explique-t-il.
Faire de la recherche, conclue Jamal Khalil, c'est aussi un acte de liberté. Un engagement à penser par soi-même, à explorer, à confronter les idées.